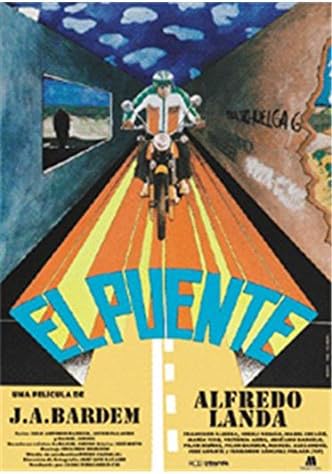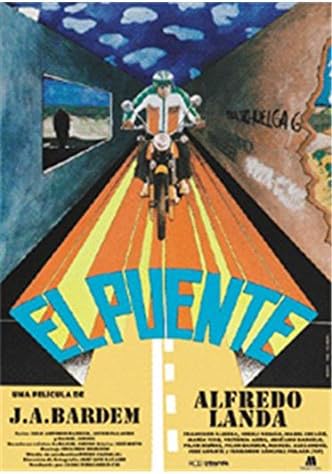
El Puente - Juan Antonio Bardem - 1977
(oui il s'agit bien du père de Javier

)
Premier plan : un gros plan sur un cul. Deuxième plan : un gros plan sur une poitrine. Troisième plan : un groupe d'homme, des mécanos, qui sifflent le passage de la femme dont nous n'aurons rien vu d'autre. Parmis eux : Juan, que nous suivrons durant le film. Profitant d'un long week-end il décide à l'improviste de quitter Madrid à moto pour rejoindre la Costa del Sol, 600km au sud. Autant dire que l'aventure, démesurée, est vouée à l'échec dès le départ. On songe vaguement à Week-End de Godard pour quelques idées (l'embouteillage, le groupe de saltimbanque et la batterie dans le champ, le toréador costumé qui surgit de nul part etc) mais le tout finira plutôt par ressembler à un Quichotte des temps modernes. Les rencontres et mésaventures se multiplient pour Juan, l'occasion pour Bardem de dresser le portrait d'une Espagne qui sort tout juste de la dictature, avant même ses premières élections démocratiques. Côtoyant quelques instants le haut, le bas, la gauche et la droite de la société, Juan réalise progressivement l'importance de la solidarité. Le dernier plan du film le voit s'engager dans le syndicat de son garage... Ce road-movie initiatique est donc avant tout l'histoire du changement de regard d'un travailleur sur le monde qui l'entoure... enfin, sauf sur les femmes. Ici elles seront toujours soit des bouts de viande qu'on essaye de sauter, soit des pleureuses. C'est aussi ça faire le portrait d'une société dans les années 70, mais il est difficile de faire comme si de rien n'était 50 ans plus tard.

Moins frappé que son précédent film (et assurément que son suivant, Dracula, que je n'ai pas encore vu), Kontinental' 25 perd en folie ce qu'il gagne en précision. Il est aussi intéressant de voir la façon dont l'auteur reprend certains thèmes ou approches de mises en scène, qu'il n'hésite pas à remalaxer pour narrer des choses différentes (je pense au rapport urbain/image/corps qui ouvre le film tout comme c'était le cas dans Bad Luck Banging, ou encore au sujet de la construction d'un immeuble qui était un élément central dans N'attendez pas trop...).
Il y a d'ailleurs, et peut-être de plus en plus, un vrai sens de la composition dans ses plans. Non pas qu'ils soient "beaux" ou "bien cadrés" (on aurait tendance à dire le contraire) mais, à l'observation, ils se révèlent très riches par le jeu entre ses avants et ses arrières plans, par l'ensemble des images qui gravitent dans les situations et autours des personnages. Comme beaucoup de plans durent (tout ces dialogues en plan-séquences : chapeau), l’œil à le temps de s'y promener et les éléments se révèlent rarement anodins. D'une certaine façon Jude arrive à faire une sorte de "montage image" à l'intérieur même de ses plans, semblant pousser d'un cran encore encore l'idée du montage Godardien. Il n'y a d'ailleurs peut-être que lui pour filmer si bien notre monde rempli d'images et d'écrans, de téléphone ou de télévisions, sans que cela ne fasse faux ou forcé.
Je crois que Kontinental'25 tient beaucoup sur l'idée du rapport entre silence et parole. Ou peut-être sur la façon dont les paroles sont très silencieuses, car creuses : la discussion avec la mère qui s'envenime en 5 secondes ressemble à des commentaires sous un post sur un réseau social, les citations zens de l'étudiant ressemblent à des "motivations posts" qui défilent sur un smartphone, et que dire quand arrive l'heure du pasteur... Il y aussi ce "silence" de l'arrière-plan qui vient toujours dire autre chose, ou quelque chose de complémentaire, à ce qui se dit. C'est ce silence, le silence du contexte, de la société, de notre impuissance et de l'aliénation de notre époque que souligne Radu Jude, dans un sarcasme teinté de tristesse. Tout m'est apparu quand l’héroïne, fuyant finalement vers ses vacances, disparait et que le film se termine sur des paysages silencieux et des bâtiments en construction, avant de se clore sur l'image d'un cimetière plein à craquer. C'est ce poids d'un système mutique, dominant et écrasant, en un sens "politiquement malade", que pointe de la sorte l'auteur.

J'ai eu l'impression pendant deux heures d'être devant un clip pour Cartier. Perdu : c'est finalement une malle Louis Vuitton qui vient ostensiblement se montrer à l'image. En tout cas, tout est là, des costumes à la photographie, pour faire croire à un long spot de mode. C'est kitch à crever, esthétisant jusqu'à la moelle, formel à 2000% avec un fond mortifère en diable. Vraiment tout pour plaire à un certain imaginaire de l'hyper-richesse, au point que je suis certain que l'idée des bougies "finales" ont été pompés à Urs Fischer, artistes contemporains chouchou de Bernard Arnaud et Maja Hoffman.
Il n'y a aucun doute que le problème du film vient de là : trop d'argent, à ne plus savoir quoi en faire (une minute de ce machin doit couter plus cher que l’entièreté de son premier film, non ?) au point que l'on se paye 5 courts-métrages qu'on tente vaguement de faire tenir ensemble par un concept bête à manger du foin (oui, on a vu Holy Motors, et on à aussi vu les films que Carax avait lui même pompé...). Preuve si il en fallait : des fonds illmités n'ont jamais donné de l'esprit où des idées. Le résultat est donc une boursouflure prétentieuse et creuse à crever, dont chaque ligne de dialogue semble avoir été écrit par un collégien. C'est sidérant. J'ai eu envie de me tirer au bout de 5 minutes (ce qui ne m'arrive jamais) et j'ai du lutter durant les 2 premières parties, avant de me calmer légèrement avec la 3ème (car le petit garçon est touchant) et la 4 (car le plan-séquence est impressionnant, même si il ne sert à rien et ne raconte pas tripette : pur spectacle). Il est d'ailleurs assez drôle d'y voir surgir en arrière-plan une projection de "L'arroseur-arrosé" que Bi Gan avait lui même imité en scène d'ouverture.... tenterait-il de nous dire quelque chose de sa nouvelle position de chouchou d'un certain cinéma contemporain ? Le pauvre... Espérons qu'il s'en sorte un jour car pour l'heure c'est la catastrophe.